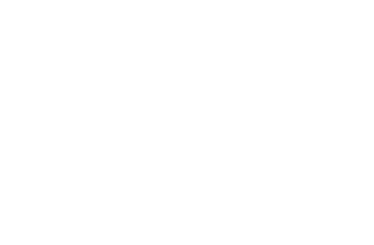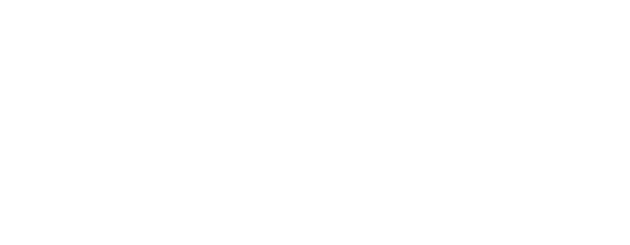Depuis quelques années, on assiste à une prolifération des travaux de recherche en histoire de l’art et en muséologie consacrés aux arts autochtones. Des chercheuses émergentes, notamment, contribuent considérablement à ce champ de recherche encore récent au Québec, en témoigne les nombreuses thèses et les mémoires de maîtrise déposés ou en cours. Dans le cadre de cette table-ronde qui rassemble une professeure et des étudiantes au doctorat dont les travaux concernent des aspects variés de l’étude des arts autochtones, nous chercherons, dans un premier temps, à mettre en valeur la diversité des sujets de recherche, des approches, des méthodologies et des cadres théoriques mobilisés; puis, dans un deuxième temps à réfléchir à la place actuelle de ces travaux dans les milieux de la recherche et de l’art. Nous pourrons nous demander ce qui motive un tel engouement actuellement pour les arts autochtones et, surtout, quels sont les mouvements actuels qui se dessinent dans le monde académique, puis comment approcher de manière éthique et responsable le corpus des arts visuels autochtones.
Quand : Mercredi le 18 mars de 11h30 à 13h00
Où : Carrefour des arts et des sciences, UdeM, local C-2059
Ces questions réuniront donc plusieurs intervenantes autour d’une discussion que nous souhaitons conviviale :
Alexia Pinto Ferretti (UdeM), candidate au doctorat interuniversitaire en histoire de l’art. Sa thèse porte sur la pratique du selfie dans l’art contemporain autochtone du Canada. S’éloignant de la traditionnelle question du narcissisme en ligne, elle considère plutôt le selfie comme étant un vecteur d’agentivités multiples pour les communautés autochtones. Elle donne présentement un cours à l’Université de Montréal sur l’histoire de l’autoportrait dans une perspective féministe, post-coloniale et décoloniale. Depuis 2017, Alexia participe à différents projets de recherche et d’exposition entourant les expressions créatrices autochtones urbaines. Elle travaille présentement en collaboration avec la professeure Louise Vigneault sur le projet « Zacharie », nommé en l’honneur du peintre wendat Zacharie Vincent, visant à créer des pages Wikipédia sur des artistes visuels autochtones francophones. Elle publie régulièrement des articles sur des artistes des communautés culturelles ou autochtones dans les revues RACAR, Espace art actuel et Ciel Variable.
Marie-Charlotte Franco (UQAM) est titulaire d’une licence en sciences sociales mention histoire (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et d’une maîtrise en muséologie (UQAM). Ses travaux ont été publiés dans plusieurs revues (Muséologies, Vie des arts, Inter, Cahiers du CIERA, Histoire Québec). Membre du CIERA, du CRILCQ et de l’Institut du patrimoine (UQAM), elle est également chargée de cours en muséologie à l’UQAM et à l’UQO et s’investit auprès du Cercle des Premières Nations de l’UQAM. Dans sa thèse de doctorat, elle observe les collaborations envisagées par plusieurs institutions muséales au Canada, et plus spécifiquement par le Musée McCord, avec les Premiers Peuples. Dans un premier temps, la recherche permet de mieux comprendre comment le Musée s’insère dans un mouvement pancanadien d’ouverture aux communautés autochtones. En second lieu, la recherche se concentre sur les modalités collaboratives mises en place dans les expositions avec les Premiers Peuples présentées au Musée McCord depuis 1992. En somme, cette thèse tend à mettre en lumière les initiatives individuelles et collectives qui ont permis, depuis près de trente ans, de bonifier les discours et les pratiques muséales à l’égard des Autochtones.
Sophie Guignard (UQAM) est doctorante en histoire de l’art, et spécialisée en études photographiques. Elle détient un Master en politiques culturelles et une Maîtrise en sciences politiques de l’Université Paris 7 Denis Diderot. Elle a notamment collaboré pour les revues Ciel Variable, Inter Art actuel, Artpress, Esse et Captures. Figures, théories et pratiques de l’imaginaire. Sa thèse porte sur l’autoreprésentation photographique dans des catalogues et brochures d’expositions collectives de photographes autochtones organisées en Amérique du Nord depuis les années 1980. L’autoreprésentation est ici appréhendée comme un mouvement collectif, dont l’enjeu principal consiste en la reprise de contrôle des moyens de représentation d’un groupe social ou culturel donné. À travers l’étude de ces publications ainsi que des entrevues avec des photographes, il s’agit d’examiner les stratégies visuelles et discursives déployées dans ces imprimés, afin d’en analyser les enjeux politiques, historiques et culturels.
Gabrielle Marcoux (UdeM), est candidate au doctorat en histoire de l’art. En 2015, 2016 et 2018, elle participe à la co-organisation du colloque international Regards autochtones sur les Amériques dans le cadre du Festival Présence autochtone, à Montréal, aux côtés d’Isabelle St-Amand (Queen’s University) et d’André Dudemaine (Terres en vues). C’est d’ailleurs avec ces deux collègues qu’elle codirige un numéro spécial de la Revue canadienne d’études cinématographiques (Canadian Journal of Film Studies) intitulé « Cinémas et médias autochtones dans les Amériques : récits, communautés et souverainetés », qui sera publié ce printemps. Ses recherches portent sur la déconstruction et l’autochtonisation d’outils étatiques de conceptualisation et de gestion du territoire, comme la cartographie officielle et la législation territoriale, dans l’art autochtone actuel au Canada. Elle s’intéresse aux rapports entre corps (physiques et politiques), territoires et langages, tel que décolonisés à travers des œuvres s’appuyant notamment sur une résurgence d’épistémologies, de politiques et de récits autochtones ancestraux. Ainsi, elle se penche sur les divers discours visuels entourant les notions de souveraineté territoriale, de souveraineté rhétorique et de souveraineté mémorielle.
Caroline Nepton Hotte (UQAM) qui s’intéresse, depuis plus de vingt ans, aux questions autochtones, particulièrement aux femmes des Premières nations du Québec. Elle est candidate au doctorat au Département de sciences des religions et membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA), du Groupe de recherche sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC), du Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones – Mikwatisiw et du conseil d’administration de la Société Recherches amérindiennes au Québec. Membre de la communauté ilnue de Mashteuiatsh, au Québec, elle a travaillé pendant plus de dix ans en relations publiques au sein d’institutions gérées par et pour les Premières Nations, comme l’association Femmes autochtones du Québec et la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Titulaire d’une maîtrise en communications publiques à l’Université Laval (2005), Caroline a travaillé également comme journaliste à Radio-Canada et CBC (2007-2016), où elle a entre autres développé un contenu éducatif et informatif sur les Autochtones pour des émissions de radio, le documentaire 8e Feu et un site Internet spécialisé : Espaces autochtones.
Louise Vigneault (UdeM), professeure au département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques. Spécialiste de l’art nord-américain, elle s’intéresse aux imaginaires collectifs, aux constructions culturelles ainsi qu’aux stratégies de représentation identitaire. En 2016, elle publiait aux éditions Hannenorak une monographie consacrée à l’artiste wendat Zacharie Vincent (1815-1886). Elle prépare présentement un ouvrage collectif consacré à la créativité autochtone contemporaine au Québec, ouvrage qui sera soumis sous peu aux Presses de l’Université de Montréal. Elle est également responsable de la collection «Expressions autochtones» dans cette même maison d’édition. Elle s’intéresse aussi à l’art public et commémoratif.