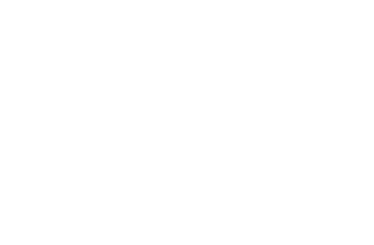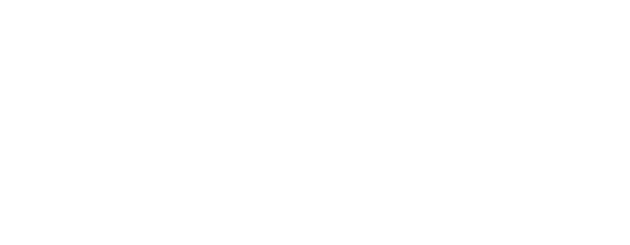Le Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA-UQO) organise un colloque d’échanges et de réflexion sur la pertinence des épistémologies autochtones face à la crise climatique actuelle : enjeux de protection et de préservation du territoire.
Le colloque se tiendra les 29 et 30 avril 2020, à Gatineau (lieu à déterminer). Le 29 avril, la journée sera consacrée aux recherches en cours, terminées ou projetées, en lien direct ou non avec la thématique du colloque. Le 30 avril, la journée sera consacrée spécifiquement à la thématique principale.
Date limite pour recevoir les propositions de communication : 20 décembre 2019
Description de la thématique
Du fait de leur mode de vie et de leur relation à la terre et à l’environnement, les différents groupes autochtones de la planète sont parmi les premiers à être confrontés et dénoncer les changements climatiques (Nakashima et al. 2012, Royer 2012). Si l’on pense aux changements climatiques, certaines régions du monde sont actuellement directement menacées soit par le phénomène du réchauffement de la planète et de ses retombées. Ces changements ont des incidences permanentes sur les modes de vies humains bien évidemment, mais également sur tous les écosystèmes ambiants (Maffi 2001, McGregor et al. 2004, Roturier et Roué 2009) .
Dans plusieurs régions du monde, dans une perspective commerciale, économique et d’exploitation des territoires, les groupes autochtones ont été et continuent d’être évincés ou déplacés sous prétexte qu’ils mettent en péril l’équilibre faunique et écosystémique de certains milieux (Dowie, 2009 ; Hitchcock, 2019) ou encore pour permettre l’exploitation économique de leurs territoires. De larges zones de leurs territoires sont déclarées en danger et, au motif d’agir pour le bien commun, des mesures sont mises en place pour exproprier les groupes autochtones de leurs territoires au profit des États ou d’autres organisations.
En réponse, et dans une perspective d’auto-détermination, certains groupes ou individus qui se portent à la défense de leur environnement ou de leurs terres en dénonçant des activités industrielles perturbatrices des écosystèmes polluantes et destructrices, voient leurs actions criminalisées et leurs vies menacées du fait de cette contestation (Schmidt et Paterson 2009). Leur volonté de protéger leurs territoires est présentée comme allant à l’encontre du développement économique (États et/ou multinationales).
Pourtant, un consensus international reconnaît que les Peuples autochtones, qui ont un lien privilégié avec le territoire, détiennent des systèmes de connaissances qui mettent en valeur la protection de l’environnement (la Convention sur la diversité biologique, entrée en vigueur le 29 décembre 1993 traite spécifiquement des « connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales »). Dans certains pays, dont le Canada par exemple, du fait de processus nationaux de réconciliation et de décolonisation, les scientifiques et organisations publiques sont davantage interpellés pour collaborer avec les peuples autochtones, valoriser leurs savoirs et connaissances dans la protection de l’environnement et pour lutter contre les changements climatiques (Nakashima et al. 2012).
Dans ce colloque, nous proposons d’ouvrir la réflexion sur les questions suivantes : Qu’en est-il de l’intégration de ces épistémologies autochtones dans la lutte aux changements climatiques, dans la préservation de la biodiversité ou encore la protection de la faune ou de la flore (Toledo 2002, Battiste et Henderson 2000) ? Quel espace leur est laissé ou offert dans le débat actuel ? A quelles conditions, les épistémologies autochtones peuvent contribuer à renforcer le savoir collectif sur les enjeux environnementaux (Silitoe 2007, Silitoe et Marzano 2009) ? Compte tenu du fait qu’on assiste actuellement à une crise climatique (avec des impacts tels que les inondations, les feux de forêts, la dégénérescence de l’écosystème marin, les typhons, tornades et tsunamis, les séismes, etc.) ainsi qu’à des rapports économiques et de pouvoir inégalitaires, dans quelles mesures une collaboration éthique et respectueuse avec les détenteurs de ces épistémologies est-elle possible voire même souhaitable pour eux (Agrawal 2002, Silitoe et al. 2002) ?
Qu’en est-il aussi des groupes autochtones qui ne se revendiquent pas de ces épistémologies et qui occupent leurs territoires en fonction de critères qui sont perçus comme renforçant les changements climatiques en détériorant l’environnement ? Quel espace est laissé à ces perspectives qui vont à l’encontre des luttes environnementales ? Quel espace est également laissé aux pratiques alternatives de développement économique dans le contexte des luttes environnementales ? Autrement dit, que signifie être autochtone et investir dans les énergies fossiles dans le contexte actuel ? Dans quelles mesures l’équilibre des pouvoirs et l’émergence des discours différents sont négociés alors que le discours dominant statue sur une urgence climatique ? Est-il possible de prôner une approche différente et non consensuelle si l’on est issu d’un groupe autochtone ? Comment s’assurer du respect de droits fondamentaux comme celui du droit au développement économique ou du droit à l’autodétermination dans le contexte des changements climatiques ?
Ce colloque propose de :
- Réfléchir sur le rôle et l’expression des épistémologies autochtones au regard des enjeux environnementaux actuels et le rôle de certaines catégories d’acteurs au sein de la mobilisation de ces épistémologies (notamment les femmes et les jeunes).
- Regarder plus en détails à quels types d’enjeux font actuellement face les groupes autochtones pour mettre en œuvre leurs épistémologies en lien avec la protection de l’environnement, la biodiversité, la conservation des ressources et les changements climatiques.
- Mettre en lumière les discours des différents groupes autochtones dans le monde concernant le maintien de la biodiversité, de la protection de l’environnement et des changements climatiques.
- Mettre en avant des pratiques et des initiatives qui ont donné des résultats quant aux enjeux environnementaux actuels.
Thématiques de panels pour lesquels vous devez soumettre vos propositions :
- Savoirs genrés, relations au territoire et enjeux de préservation de l’environnement.
- Prises de décisions et rapports de pouvoirs : enjeux relatifs à la mise en œuvre et l’application des épistémologies autochtones face aux changements climatiques
- Perspectives juridiques : enjeux quant à la reconnaissance des épistémologies autochtones en lien avec les enjeux environnementaux.
Les personnes intéressées (spécialistes et praticiens) à présenter une communication (format académique ou autre) ou une affiche, doivent proposer un titre et un résumé de 200 mots maximum avant le 16 décembre 2019. Merci de bien vouloir nous faire parvenir vos propositions de communication ou d’affiche à l’adresse suivante : colloqueannuelciera2020@gmail.com.
Le temps alloué aux présentations est de 15 à 20 minutes (selon le nombre de participants). Un programme préliminaire vous parviendra au début mars. Lors du colloque, les lancements des livres sur les sujets reliés aux Peuples autochtones sont encouragés. Si vous souhaitez prévoir un lancement, merci de nous contacter par courriel.
Pour toutes questions, veuillez écrire à : colloqueannuelciera2020@gmail.com.
Références :
Agrawal A. 2002. « Classification des savoirs autochtones : la dimension politique », Revue internationale des sciences sociales 3 (173) : 325-336.
Battiste M.A. et J.Y. Henderson, 2000, Protecting Indigenous Knowledge and heritage: A global challenge, Saskatoon, Purich Publishing.
Berkes, F. 2009. Indigenous ways of knowing and the study of environmental change. Journal of the Royal Society of New Zealand, 39 (4) :151–156.
Berkes, F. 2012. Sacred Ecology, Third Edition. New York, Routledge.
Dowie, M. 2009. Conservation Refugees. The Hundred-Year Conflict between Global Conservation and Native Peoples. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England
Hitchcock, R.K. 2019. “The Impacts of Conservation and Militarization on Indigenous Peoples. A Southern African San Perspective”. Human nature 30 (2): 217-241.
Johannes, R.E. 2002. “The renaissance of community-based marine resource management in Oceania”. Annual Review of Ecology and Systematics 33 : 317–40.
Maffi L., 2001, On Biocultural Diversity: Linking Language, Knowledge and the Environment, Washington, DC, Smithsonian Institution Press.
McGregor D., H.A. Feit, G. McRae et W. Russel, 2004, « Traditional Ecological Knowledge and Sustainable Development: Towards Coexistence ». in G. Mario Blaser; Harvey A. Feit; McRae (dir.): In the Way of Development: Indigenous Peoples, Life Projects and Globalization. 74‑91, 92‑110, 111‑129, 130‑150. London/New York, Ze.
Nakashima, D.J., Galloway McLean, K., Thulstrup, H.D., Ramos Castillo, A. and Rubis, J.T. 2012. Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge or Climate Change Assessment and Adaptation. Paris, UNESCO, and Darwin, UNU, 120 pp.
Roué, M. 2012. « Histoire et épistémologie des savoirs locaux et autochtones », Revue d’ethnoécologie [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 02 décembre 2012, URL : http://ethnoecologie.revues.org/813.
Roturier, S. and Roué, M. 2009. Of forest, snow and lichen: Sami reindeer herders’ knowledge of winter pastures in northern Sweden. Forest Ecology and Management, 258(9): 1960–67.
Royer, M-J. S. 2012. L’interaction entre les savoirs écologiques traditionnels et les changements climatiques : les Cris de la Baie-James, la bernache du Canada et le caribou des bois. Thèse de doctorat, département de géographie, Université de Montréal.
Sadler, B. and Boothroyd, P. (eds.). 1994. Traditional Ecological Knowledge and Modern Environmental Assessment. Vancouver, Canadian Environmental Assessment Agency, International Association for Impact Assessments and University of British Columbia.
Schmidt, P. and Peterson, M. 2009. « Biodiversity conservation and indigenous land management in the era of self-determination ». Conservation Biology, 23 (6): 1458–66.
Sillitoe, P., Bicker, A. and Pottier, J. (eds.). 2002. Participating in Development: Approaches to Indigenous Knowledge. London, Routledge.
Sillitoe, P. (ed.) 2007. Local Science vs. Global Science: Approaches to Indigenous Knowledge in International Development. New York, Berghahn Books.
Sillitoe, P. et Marzano, M. 2009. “Future of indigenous knowledge research in development”, Futures 41 :13–23.
Toledo V.M., 2002, « Ethnoecology: A conceptual framework for the study of Indigenous Knowledge of Nature ». in J. R. Stepp, F. S. Wyndam, et R. K. Zarger (dir.): Ethnobiology and Biocultural Diversity: Proceedings of the Seventh International Congress of Ethnobiology. 511‑522. Athens, GA, University of Georgia Press, International Society of Ethnobiology.