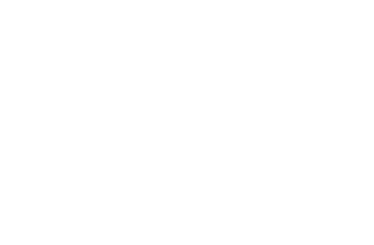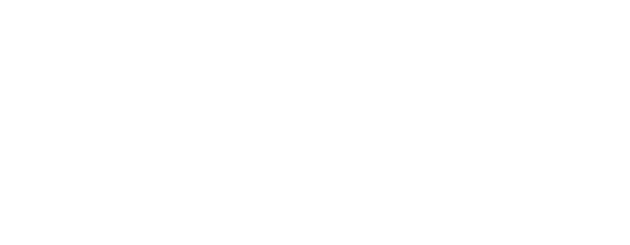Le colloque 2025 de la CASCA (Société canadienne d’anthropologie) aura lieu du 7 au 10 mai 2025, Université McGill, Montréal. Plusieurs membres du CIÉRA y organisent des colloques ou encore y donnent des communications. Voir plus bas et visitez la page du Congrès pour plus de détails.
8 mai 2023
Mondes digitaux (9h45 à 10h45)
- Du global au local, la place du smartphone dans le quotidien des jeunes Kanak du Grand Nouméa (10h27 à 10h45) – Florian Lebret (Université Laval)
Partant de données collectées sur le terrain en Nouvelle-Calédonie, cette communication traitera de l’utilisation quotidienne du smartphone par les jeunes Kanak du Grand Nouméa. La démocratisation d’internet et des smartphones, parce que participant des processus de mondialisation, y est régulièrement perçue par les ainés comme présentant une menace pour la culture kanak. Cette démocratisation participerait à un processus d’homogénéisation culturelle au profit de la culture occidentale, lequel affecterait en tout premier lieu les jeunes Kanak. Cette communication propose de s’attarder sur l’appropriation des téléphones intelligents et des effets de leurs démocratisations dans les pratiques quotidiennes des jeunes Kanak urbanisés. Elle cherchera à illustrer que les pratiques associées à ces médiums découlent des contextes locaux dans lesquels ils s’intègrent. Ainsi, la relation des jeunes interrogés à l’espace (numérique) mondialisé est négociée en fonction de leur participation à divers contextes locaux et de leurs mobilités entre la ville et le monde rural.
Art et anthropologie (11h00 à 12h30)
- Odeimen : contribuer à la sécurité culturelle par l’art anicinabe (12h12 à 12h30) – Marie-Pierre Renaud, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Chantal Simard Nattaway, Minwashin
Le projet Odeimen a été développé par Minwashin, une organisation culturelle anicinabe, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Ce projet visait à créer des points de repère pour les personnes anicinabek dans huit hôpitaux et cliniques en présentant des œuvres d’artistes de leurs communautés. Odeimen visait à accroître la sécurité culturelle des personnes anicinabek dans le domaine des soins de santé et des services sociaux. Malgré les nombreux obstacles et retards causés par la pandémie de COVID-19, huit artistes anicinabek ont participé au projet et leurs œuvres ont fait l’objet d’une exposition à Rouyn-Noranda en mai 2022 avant d’être installées dans les hôpitaux et les cliniques de la région. Cette présentation fournira des résultats préliminaires émergeant de l’analyse de données qualitatives recueillies dans le cadre d’une étude anthropologique du projet Odeimen. Une artiste ayant participé au projet prendra part à la présentation.
9 mai 2023
Cosmologies et territorialités autochtones : comparaisons et confluences Brésil-Canada (1/3) (9h15 à 10h45)
- Présentation d’Antonella Tassinari, Bianca Hammerschmidt, Diógenes Cariaga et Viviane Vasconcelos
Cosmologies et territorialités autochtones : comparaisons et confluences Brésil-Canada (2/3) (11h00 à 12h30)
- Présentation de Clarissa Rocha de Melo, Oendu de Mendonça, Francine Rabelo et Robert Crépeau
Cosmologies et territorialités autochtones : comparaisons et confluences Brésil-Canada (3/3) (14h30 à 16h00)
- « Un espace où l’on peut devenir ce que l’on veut être » : Les manières d’être genrées en territoire chez les Atikamekw Nehirowisiwok de Manawan – Étienne Levac (UQAM);
- Les dimensions d’engagement des jeunes atikamekw au sein d’initiatives de transmission des savoirs : Réflexions d’un terrain à Manawan (Lanaudière, Québec) – Camille Ouellet (UQAM);
Terre, souveraineté et résilience (14h30 à 16h00)
- Les voix des femmes inuit dans la gouvernance du territoire au Nunavik: Imaginer les futurs à travers les relations (15h24 à 15h42) – Allie Miot-Bruneau (Université Laval)
Cette recherche doctorale analyse les perspectives des femmes inuit sur le territoire au Nunavik et documente les rôles qu’elles occupent au sein et autour des espaces institutionnels chargés de sa gouvernance. Au Nunavik comme ailleurs dans l’Inuit Nunangat, les points de vue des femmes inuit sont moins sollicités et documentés que ceux des hommes lorsqu’il s’agit du territoire, bien qu’elles soient détentrices de savoirs, notamment dans le contexte d’un environnement dégradé et transformé. Cela se traduit notamment par une représentation inégale dans les espaces décisionnels liés à ces questions. Cette recherche étudie les institutions de gouvernance de l’environnement et les rencontres ontologiques qui s’y produisent, du point de vue des femmes inuit. Elle explore les préoccupations des femmes inuit concernant le présent et l’avenir du territoire, leurs aspirations quant à leur place dans la vie politique, ainsi que les continuités et reconfigurations des relations de genre dans les institutions environnementales.
10 mai 2025
Confluences en revitalisation du langage, changements et maintien (14h15 à 15h45)
- « No debemos salvar la lengua, sino a los hablantes » : le cas de la sauvegarde du maya à travers la musique au Yucatán et au Quintana Roo (14h15 à 14h38) – Honorine Guichard (Université Laval)
La langue maya yucatèque est une langue de la péninsule du Yucatán. Considérée en danger par de nombreux spécialistes, elle est le cœur de ma recherche de maîtrise. Malgré l’affaiblissement de la langue, on observe, depuis quelques années, un retour progressif des jeunes vers la langue. Marlene Chuc Maldonado considère que la musique en maya intéresse les jeunes jusqu’à leur donner envie de le pratiquer. La revitalisation des langues autochtones est un sujet actuel qui, en anthropologie langagière est relativement étudié. Cependant, l’impact de la musique dans la revitalisation langagière ne l’est pas. C’est là tout l’intérêt de ma recherche : mettre en avant l’utilisation de la musique auprès des jeunes dans la revitalisation d’une langue.
Mon analyse se base sur un séjour de terrain dans les états du Yucatán et du Quintana Roo dans lesquels j’ai colligé 28 entretiens.