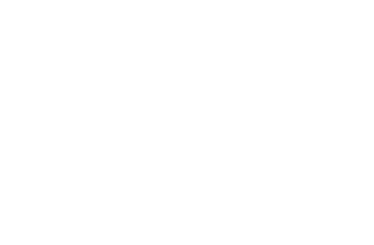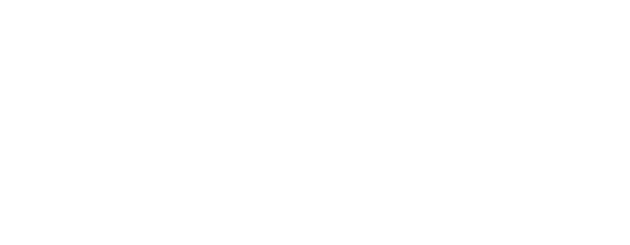La dernière Biennale de Venise (2024) a fait une large place aux propositions artistiques autochtones, tout particulièrement aux œuvres des artistes amazoniens : Joseca Mokahesi Yanomami, André Taniki Yanomami, Rember Yahuarcani et Santiago Yahuarcani, et le collectif MAHKU. Ce dernier, fondé par l'artiste chaman Ibã Huni Kuin en 2012, a bénéficié ces dernières années d’une large visibilité sur la scène internationale (Exposition Les Vivants à Lille en 2022, exposition à la SBC Galerie de Montréal en 2022, Biennale de São Paulo en 2023). Cette diffusion internationale fait partie d’une diplomatie culturelle voulue par les Huni Kuin qui cherche à établir des bonnes relations avec les étrangers (nawa) afin de faire connaitre leur culture, mais également à obtenir en retour une amélioration de leur situation économique et sociale. Il est intéressant de noter que cette logique relationnelle, fondée sur la réciprocité, s’enracine dans la cosmologie Huni Kuin. Le collectif MAHKU a par exemple choisi de représenter au centre de la murale qu’il a réalisée pour le pavillon international de la Biennale de Venise l'alligator Kapetawã (qui leur sert également d’identité visuelle). C’est Kapetawã qui, dans les récits cosmogoniques des Huni Kuin, a permis à leurs ancêtres de survivre en les autorisant à monter sur son dos pour franchir un fleuve et accéder ainsi à des territoires riches en vivres. Ce sont précisément ces liens entre la cosmologie, l’art et le cosmopolitisme autochtones que nous aimerions approfondir au cours de cette table ronde.
Personnes participantes :
- Ibã Huni Kuin (Fondateur de MAHKU)
- Léuli Eshrāghi (Musée des beaux-arts de Montréal)
- Els Lagrou (Université Fédérale de Rio de Janeiro)
- Magda Helena Dziubinska (CIÉRA, Université Laval)
- Marie-Ève Courtemanche (CIÉRA, Université Laval)
- Daniel Dinato (GRIAAC/CIÉRA-MTL, UQAM)
- Laurent Jerôme (GRIAAC/CIÉRA-MTL, UQAM)
- Jean-Philippe Uzel (GRIAAC/CIÉRA-MTL, UQAM)