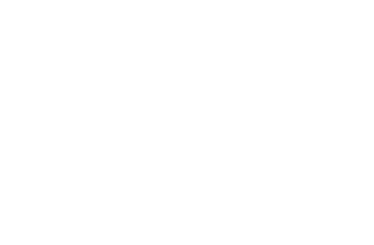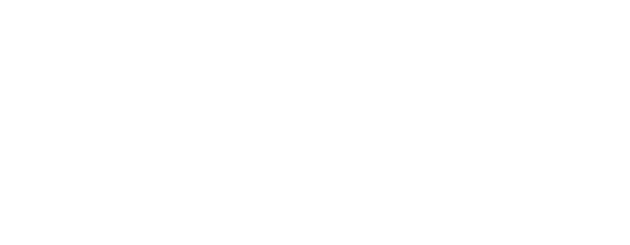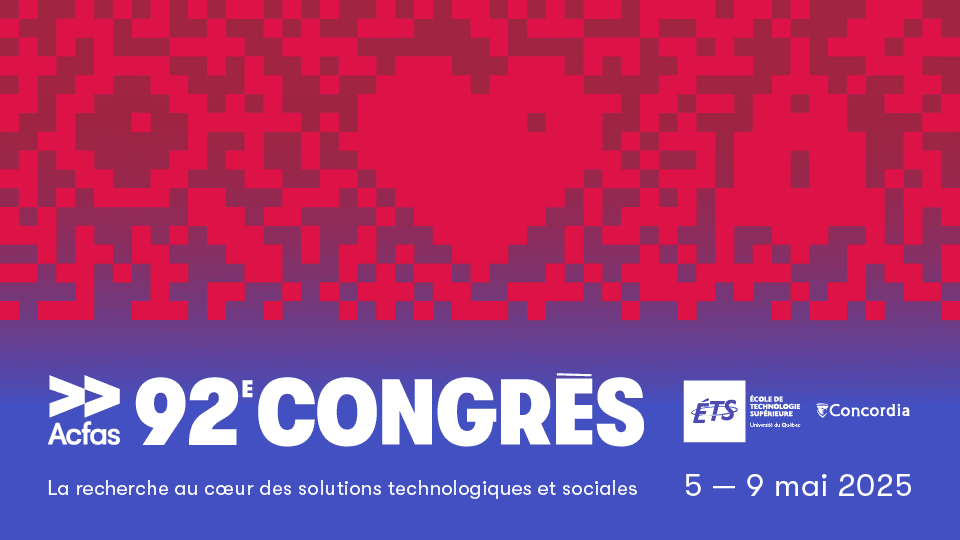
Le 92e Congrès de l’ACFAS aura lieu du 5 au 9 mai 2025 sur le campus de l’École de technologie supérieure (ÉTS). « La recherche au cœur des solutions technologiques et sociales ». Plusieurs membres du CIÉRA y organisent des colloques ou encore y donnent des communications. Voir plus bas et visitez la page du Congrès pour plus de détails.
5 mai 2025
Responsables : Marie-Claude Tremblay (Université Laval), Sandro Echaquan (Université de Montréal), Karine Millaire (Université de Montréal), Amélie Blanchet Garneau (Université de Montréal) et Christine Cassivi (Université de Montréal)
Les iniquités de santé persistantes vécues par les Peuples Autochtones du Canada trouvent racine dans les répercussions continues du colonialisme, qui a une influence indéniable sur différents déterminants sociaux de la santé des autochtones, incluant l’accès primaire (entrée dans le système) et secondaire (utilisation) aux services de santé. De fait, les systèmes et les services de santé, dans leur conception et leur fonctionnement, continuent de refléter des structures coloniales et des relations de pouvoir inégales. Le racisme systémique qui sévit dans ces institutions ne se limite pas à des comportements individuels ou des discriminations explicites, mais est profondément enraciné dans des mécanismes institutionnels, des pratiques organisationnelles et des politiques qui désavantagent systématiquement les Peuples Autochtones. Il se traduit notamment par des programmes et des pratiques de soins qui sont d’emblée basés sur les valeurs et les perspectives de la culture dominante et qui ne prennent pas en compte les besoins des Peuples Autochtones, ainsi que par des interactions avec les prestataires de soins marquées par la discrimination et le racisme. En plus d’être inacceptables à la lumière des valeurs fondatrices de notre système de santé, ces iniquités d’accès contribuent à alourdir un fardeau de maladie et de souffrance évitable pour ces populations.
Des soins culturellement sécuritaires, pensés par et pour les Peuples Autochtones ou développés dans le cadre de partenariats équitables entre communautés autochtones et organismes de santé, constituent la solution plaidée par les principaux acteurs de ce domaine pour lutter contre les discriminations et les relations de pouvoir inéquitables dans le système de santé. Des soins culturellement sécuritaires font référence à des soins qui sont prodigués dans le respect, l’équité et la sécurité en fonction des normes culturelles et des valeurs de la personne. Des recherches récentes mettent en évidence la nécessité de changements systémiques profonds, capables de transformer les politiques et les pratiques institutionnelles afin d’y arriver, ainsi que l’importance de soutenir l’autonomisation et la résurgence autochtones dans le développement de leurs propres soins de santé.
Bien qu’elle soit reconnue par plusieurs acteurs comme un concept pertinent ayant le potentiel d’avoir des retombées significatives pour les populations autochtones, la sécurité culturelle demeure un concept relativement récent, complexe, défini de manière variée, difficile à appréhender et à traduire concrètement. Il y a encore très peu d’applications pratiques qui restent fidèles à ce concept dans les politiques, les formations ou les pratiques de soins. Ce colloque, suivant un format de cercles de partage successifs, présentera l’expérience de ceux et celles qui ont cherché à la mettre en pratique au moyen de divers partenariats et initiatives.
- 8h45 à 10h30 – 1er cercle : Mise en commun des expériences concernant des initiatives de sécurité culturelle dans les soins
Présidence/Animation : Marie-Claude Tremblay (Université Laval); Participation : Dave Bergeron (Université du Québec à Rimouski), Sandro Echaquan (Université de Montréal), Joannie Gill (Utapi Consultants), Anne-Marie Leclerc (Université du Québec à Trois-Rivières) et Julie Rock (Université du Québec à Trois-Rivières)
Ce premier cercle de partage réunira des experts qui partageront leurs expériences quant à l’implantation d’initiatives visant la sécurité culturelle dans les soins de santé. À travers une mise en commun des réussites, des apprentissages et des défis rencontrés, les participants exploreront les approches ayant favorisé le développement d’interventions de soins culturellement sécuritaires, respectueux et équitables. Cet échange permettra de contribuer à la réflexion collective et d’identifier des pratiques exemplaires en matière de sécurité culturelle. Ce cercle de partage sera suivi d’une période de questions et d’échanges avec les participants.
- 10h30 à 12h00 – 2e cercle : Partage sur les stratégies pour naviguer les résistances individuelles, organisationnelles et structurelles à l’implantation d’initiatives de sécurité culturelle
Présidence/Animation : Amélie Blanchet Garneau (UdeM)
Participant·e·s : Dave Bergeron (UQAR), Sandro Echaquan (UdeM), Joannie Gill (Utapi Consultants), Annie Hervieux (Université Laval), Anne-Marie Leclerc (UQTR), Julie Rock (UQTR)
L’implantation de soins culturellement sécuritaires se heurte souvent à diverses résistances, qu’elles soient individuelles, organisationnelles ou systémiques. Ce cercle de partage offrira un espace de discussion pour échanger sur les stratégies permettant de surmonter ces résistances et de favoriser un changement durable. En s’appuyant sur les expériences des participants, ce cercle de partage permettra d’identifier les défis rencontrés, les leviers d’action ainsi que les pistes de solution pour surmonter ces obstacles et promouvoir un engagement réel envers la sécurisation culturelle. Ce cercle de partage sera suivi d’une période de questions et d’échanges avec les participants.
535 – Kiskêyihtamowin : résurgence des pédagogies autochtones (de 9h20 à 17h00)
Responsables : Robert-Falcon Ouellette (Université d’Ottawa) et Caroline Hervé (Université Laval)
Le colloque Kiskêyihtamowin : résurgence des pédagogies autochtones se penche sur les défis et les occasions liés à la revitalisation des systèmes éducatifs autochtones au Canada. Historiquement, l’éducation autochtone a été marquée par des tentatives d’assimilation, notamment par l’entremise des pensionnats, où des générations d’enfants ont été privés de leur langue, de leur culture et de leurs racines. Ces pratiques ont laissé des cicatrices profondes dans les communautés autochtones, mais aujourd’hui un mouvement de réappropriation des systèmes d’éducation, des pédagogies et des savoirs est en cours.
Ce colloque vise à explorer comment l’éducation peut devenir un vecteur de guérison et d’émancipation pour les peuples autochtones. Nous aborderons la question de la revitalisation linguistique, les efforts pour intégrer les savoirs traditionnels dans les programmes scolaires ainsi que les approches innovantes pour soutenir les enseignants autochtones. De plus, le colloque examinera comment l’éducation autochtone peut enrichir le système éducatif canadien dans son ensemble, en proposant une perspective ancrée dans des valeurs communautaires, le respect de la terre et la transmission intergénérationnelle.
Au moyen de discussions entre chercheurs, étudiants, éducateurs et leaders autochtones, ce colloque entend encourager un dialogue qui met l’accent sur la réconciliation, la décolonisation des systèmes éducatifs et la valorisation des différents systèmes de savoirs. Il s’agit non seulement de réparer les injustices du passé, mais aussi de construire un avenir où les voix autochtones occupent une place centrale dans le paysage éducatif canadien.
- 9h35 – Réconciliation et décolonisation par l’éducation – Jean-Luc Ratel (Université Laval)
- 10h10 – Le Programme de Transition Axé sur les Autochtones : Réflexion critique sur l’impact, les défis, la résistance institutionnelle et l’évolution de l’éducation autochtone – Robert-Falcon Ouellette(Université d’Ottawa)
- 10h45 – Réseau de connaissances : Expériences des universitaires autochtones du sud du Brésil dans les politiques publiques d’éducation autochtone – Clarissa Rocha de Melo
9 mai 2025
Responsables : Vijonet Demero (INUFOCAD), Martin Maltais (UQAR), Theus Beguens (INUFOCAD & PARTENAIRES UNIVERSITAIRES) et Pierre Michelot Jean Claude (Université Laval)
Le contexte socioéducatif postcolonial est globalement caractérisé par une forme moderne de colonisation de la pensée au mépris des savoirs épistémiques locaux, ancestraux et autochtones (Freire, 1974; Damus, 2023). Cette forme de colonisation de la pensée s’est installée tant dans les espaces de production et de transmission des savoirs reçus (écoles, universités, centres d’études) que dans les espaces de communication et de vulgarisation des savoirs diffus (colloques, journaux, manuels, éditions, revues scientifiques). C’est un contexte qui rappelle le passé colonial et esclavagiste ainsi que le poids de l’héritage colonial dans la construction et l’imposition du savoir du passé au présent (Schmidt, 1984; Morse, 1981; Bormans, 1996), puis, qui interpelle au nécessaire combat intellectuel pour la déconstruction et la décolonisation du savoir (Luste Boulbina, 2013; Iveković, 2012).
C’est dans un tel contexte historique que sera organisé, du 8 au 9 mai 2025, dans le cadre du 92e congrès de l’Acfas, en collaboration avec l’École de technologie supérieure et l’Université Concordia, un colloque scientifique international autour du thème : mémoire de l’esclavage, l’héritage colonial et la décolonisation du savoir. Ce colloque est réalisé conjointement par le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en éducation et gouvernance (LIREG) et l’École doctorale Sciences humaines et sociales (SHS) de l’Institut universitaire de formation des cadres (INUFOCAD) avec la collaboration de divers partenaires institutionnels.
Les chercheurs et chercheuses de différentes nationalités et universités en profiteront pour communiquer les résultats de leurs travaux scientifiques et lancer officiellement la revue universitaire multidisciplinaire Revue d’enquêtes et savoirs universitaires multidisciplinaires essentiels (RESUME) : un double espace alternatif de communication et de vulgarisation scientifique, ouvert à un fructueux dialogue entre les différents savoirs épistémiques et alternatifs de l’humanité.
L’aménagement du double espace accessible du colloque CUM2025 et de la revue scientifique RESUME vise à développer des canaux de communication et de vulgarisation accessibles pour des dialogues productifs entre science et société. Pour une science juste et inclusive, il entend faire sortir de l’obscurité une importante somme humaine de savoirs épistémiques essentiels et alternatifs, longtemps asphyxiés par les courants de pensée dominants et les marchés d’édition oligopolistiques. Il propose de promouvoir la justice épistémique et la décolonisation des savoirs humanisés par l’entreprise des enquêtes empiriques et des recherches scientifiques, par l’octroi de la parole et de l’espace aux victimes d’injustice épistémique, par la valorisation des approches décoloniales et réparatrices.
- 15h30 – Récits brisés, voix retrouvées : une analyse rhétorique de l’exposé des motifs de la loi Taubira – Yvan Tchanga (Université de Montréal)